La Disparition, un nouveau média « épistolaire » lancé par deux anciens de l’école de journalisme de Toulouse (EJT), propose des reportages sous forme de véritables courriers distribués dans les boîtes aux lettres. Annabelle Perrin, cofondatrice, en explique le concept et la genèse.
Vous avez lancé un média à la forme atypique. Pouvez-vous en dire plus ?
Annabelle Perrin : Toutes les deux semaines, on envoie une enveloppe avec à l’intérieur une lettre d’une dizaine de pages. C’est un récit qui raconte une disparition de quelque chose d’existant. Un quartier, un métier, un glacier… Tous les sujets sont possibles. Il y a également une carte postale pour illustrer le récit, une carte de visite présentant rapidement l’auteur, une grille de mots-croisés, un nota bene pour expliquer un peu les coulisses de l’article et donner des pistes pour l’approfondir. Et aussi un petit strip de BD, qui fait écho avec le sujet traité. L’abonnement coûte 11 euros par mois, soit 5,50 l’enveloppe.
D’où vient l’idée ?
À la sortie de l’école de journalisme de Toulouse (EJT), avec François – cofondateur du média -, on pensait déjà au thème de la disparition. On avait l’idée de raconter la société française comme si on lui enlevait tout à coup quelque chose qu’on croyait là pour toujours, comme la prison ou l’armée… On aimait bien cette idée, mais il y avait un côté science-fiction, trop dystopique, qui la rendait difficile et bancale. Le premier confinement est arrivé et on a perdu nos piges, on n’avait plus de boulot, on se demandait quoi faire. Alors on y a repensé et on s’est dit que finalement, beaucoup de choses disparaissent déjà. Rien que les espèces et la biodiversité… Pas besoin d’inventer, il suffit qu’on chronique les disparitions en cours dans notre monde. On pourrait croire que c’est un thème qui restreint, mais au contraire, c’est assez large, ça englobe beaucoup de choses.
Comment s’est construit le projet, financièrement parlant ?
On avait une somme dérisoire de côté et personne dans nos proches qui travaille dans le journalisme ou l’édition pour nous donner des conseils. Même très peu de réseau et de connaissances, on n’avait jamais vraiment travaillé en rédaction… Puis on est tombé sur le compte Twitter d’une jeune société nommée Médiane, qui aide au développement des médias. Ils nous « mentorent » pour une somme raisonnable, en nous donnant des astuces pour savoir qui contacter, comment rédiger des mails ou encore pitcher un projet… Ils ont aussi conçu notre site web. À partir de là, on a lancé une campagne de prévente sur KissKissBankBank, où on a expliqué le concept et proposé différentes formules d’abonnement. Ça nous a permis de récolter 40 000 euros. Pour le reste, on vit seulement de nos lecteurs. On est 100% indépendants.
Le titre du média est une référence au livre La Disparition de Georges Perec. Avez-vous eu d’autres influences ?
C’est banal comme réponse, mais il y a déjà la revue XXI, car ça reste encore rare en France de faire du grand reportage comme eux. Il y a aussi Le Tigre, un projet un peu expérimental, qui cherchait à décloisonner les formats traditionnels, avec des feuilletons, des romans photos… J’adorais ça. Sinon, François Ruffin et Fakir ont réédité un livre de Jean Teulé intitulé Gens de France et d’ailleurs, qui relate des histoires de journalistes satiriques comme ceux de Hara-Kiri. Une sorte de reportage qui mélange prises de notes, dessins, photos… Et mis en scène, avec un ton un peu vulgaire… Ça m’a vraiment marqué.

Chaque lettre commence par « À toi qui me lis ». Photo © Christelle Perrin
Quels types d’auteurs rédigent les lettres et comment les choisissez-vous ?
Nos papiers font entre douze et quinze feuillets, parfois même plus. Il faut donc des personnes qui aiment écrire au long cours, l’enquête et le reportage. Mais il faut aussi savoir raconter les coulisses de l’article et apprécier de se mettre un peu en scène, puisque c’est écrit à la première personne, comme dans une vraie lettre. En tout cas, nos auteurs sont tous des pigistes, journalistes ou écrivains.
Le format épistolaire, les récits à la première personne, le tutoiement… L’objectif, c’est de créer une proximité avec vos lecteurs ?
Au début, on n’a pas pensé à la lettre pour la question de proximité. On s’est juste dit que ce serait bizarre de faire notre média portant sur des disparitions à travers un site internet. Alors que le papier, la correspondance, s’envoyer des lettres… Tout ça disparaît justement, les gens ne s’écrivent plus. Mais c’est vrai qu’avec du recul, on se rend compte qu’inconsciemment, il y avait une volonté de créer de lien, de se rapprocher, de construire quelque chose d’intime.
Vous vous revendiquez également comme un média « politique ». À quel niveau ?
Ne pas parler de tambouilles politiciennes est déjà un choix politique. On est exaspérés, comme beaucoup de journalistes, des alliances, de toute l’ambiance qu’on peut voir en ce moment, par exemple avec la Primaire populaire… En fait, un article politique, c’est tout ce qu’il n’y a pas dans la « rubrique politique » d’un journal. Il faudrait en réalité l’appeler « rubrique parti politique ». Tout le reste par contre, c’est politique. Ce qui touche vraiment la vie des gens, ce qui les concerne directement. C’est pour ça qu’on précise exprès qu’on est un aussi média politique. Pour marquer cette volonté. Et aussi pour mobiliser, dans notre lutte contre les disparitions.
Vous avez des premiers retours, des chiffres ?
La première lettre, écrite par Quentin Muller, racontant la disparition de l’arbre dragon à Socotra, une île au large du Yémen, a été envoyée à 1400 personnes. Ça comprend les gens qui l’ont achetée via la campagne de prévente et ceux qui se sont abonnés depuis.
D’autres projets sont prévus pour la suite ?
On a déjà le club des disparus volontaires, qui est à la fois un club de marche, de lecture et de correspondance. On organise des journées, avec les auteurs, autour d’une disparition traitée dans une de nos lettres. Par exemple, la lettre n°3 racontera la disparition du syndicalisme de gauche chez les dockers de Dunkerque. On va y aller, pour voir un bâtiment qui symbolise ce déclin et visiter les lieux. Il y aura aussi d’anciens dockers sur place. L’idée, c’est aussi de pousser plus loin cette proximité, de se dire qu’on fait des lettres mais on peut aussi voir tout ça en vrai, ensemble. Ça coûte 30 euros par an en plus, pour les abonnés. Pour la suite, on réfléchit… Par exemple à faire une réédition d’un ensemble de lettres, quand il y en aura beaucoup.
Si vous deviez retenir une disparition que vous regrettez particulièrement, ce serait laquelle ?
Quand on a lancé le média, on a réfléchi à des sujets qu’on pourrait traiter. J’ai tout de suite pensé à la ville de mes grands-parents à la frontière belge, Quiévrechain. Un lieu où vivaient beaucoup de mineurs, immigrés polonais. J’ai moi-même des origines polonaises. Mon grand-père me raconte souvent son arrivée en France, dans ces quartiers où le Parti communiste français (PCF) était très influent, où cohabitaient une culture à la fois française et polonaise. Toute cette mémoire, aujourd’hui, a complètement disparu. Ça me touche particulièrement.
Photo d’entête © Christelle Perrin























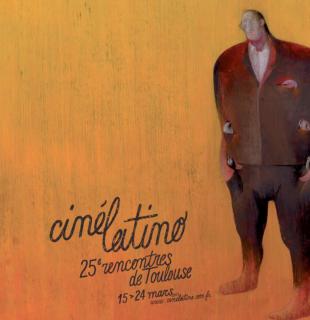







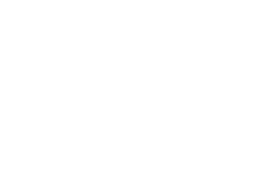 Suivez-nous sur Youtube
Suivez-nous sur Youtube