Olympe de Gouges, révolutionnaire montalbanaise. Image libre de droits.
À l’occasion du 8 mars et de la journée internationale des droits des femmes, Univers-cités vous invite à remonter dans le temps pour (re)découvrir six femmes occitanes qui ont marqué l’Histoire.
Du XVIè siècle à la Seconde Guerre mondiale, ces figures féminines, ont chacune à leur manière cassé les codes de leurs sociétés respectives, parfois au péril de leur vie, afin de défendre leurs idées. Voici leurs histoires.
Clémence Isaure, la légende toulousaine
Bien que son histoire repose davantage sur une légende que sur des faits historiques, Clémence Isaure est l’un des personnages les plus emblématiques de la Ville rose. Au début du XVIè siècle, des académiciens des Jeux Floraux l’ont affilié à la noble famille des Ysalguier. L’objectif ? Obtenir une plus grande indépendance de leur institution toulousaine. Il a donc été imaginé que l’héritière aurait légué certains de ses biens à l’Académie afin que les concours de poésie puissent perdurer.
Depuis, à Toulouse, sa légende n’a jamais cessé de grandir et a même donner lieu au baptême de rues ou d’écoles, en son honneur. Son empreinte est telle qu’en 2024, la mairie de Toulouse a également nommé l’un des tunneliers pour la ligne C du métro « Clémence Isaure ». Elle symbolise l’art de la poésie, le lyrisme, et la pérennité des Jeux Floraux qui ont célébré leur 700ème anniversaire l’an passé.
Paule De Viguier ou « la Belle Paule »
Contrairement à Clémence Isaure, souvent citée comme son amie, Paule De Viguier a bel et bien existé. Comme l’indique son surnom, cette jeune fille du XVIè siècle était connue pour sa beauté. Saisi par ses traits, le roi François 1er l’aurait surnommée « la Belle Paule » lors d’une visite à Toulouse. Après cet évènement, les Toulousains eux aussi stupéfaits par son charme hors normes, se ruaient sous sa fenêtre pour l’admirer.
L’effervescence était telle, que les Capitouls ont finalement condamné Paule De Viguier à un arrêt. Celui-ci stipulait que la jeune fille pouvait se promener à visage découvert deux fois par semaine. Aujourd’hui, son portrait figure dans la salle des Illustres du Capitole faisant de sa beauté un trésor immortel du patrimoine toulousain.
Olympe de Gouges, la montalbanaise révolutionnaire
Olympe de Gouges est l’une des rares figures féminines dont la réputation n’est plus à faire. Pourtant, peu de personnes connaissent ses origines. Née le 7 mai 1748, la jeune révolutionnaire voit le jour à Montauban. D’esprit rebelle, elle est à l’origine de la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne rédigée en 1791. Elle défendait les droits civiques et politiques de ses pairs en rédigeant de nombreux écrits dont des pamphlets dénonçant la condition des femmes. Des actions qui lui vaudront de finir guillotinée le 7 novembre 1793 pour avoir osé exposer ses idées.
Moins évoqué dans les livres d’Histoire, mais tout aussi important, elle luttait également pour abolir l’esclavage des Noirs au sein des colonies françaises. Aujourd’hui, elle est considérée comme l’une des principales figures de la Révolution et comme une pionnière du féminisme.
Jean-Émilie De Villeneuve, la « sœur bleue »
Née le 9 mars 1811 au sein d’une famille religieuse, Jean-Émilie De Villeneuve crée dès 1836 la congrégation de Notre Dame de l’Immaculée Conception avec deux compagnes. Rapidement surnommées « les sœurs bleues » en raison de leurs habits, ces femmes servaient les plus démunis dans l’anonymat au sein d’une maison de Castres. Jeunes ouvrières, malades, prostituées, ou condamnés en prison, tous étaient les bienvenus.
Leur action s’est progressivement développée, jusqu’à atteindre les côtes africaines. Au Sénégal, en Gambie et au Gabon les religieuses n’ont cessé de servir leurs prochains. Touchée par l’épidémie de choléra, Jean-Émilie De Villeneuve meurt prématurément en 1854 entourée par ses « sœurs bleues ».
Marie-Louise Dissard, la résistante
Également connue sous son pseudonyme « Françoise », Marie-Louise Dissard naît à Cahors en 1881 mais son destin la mènera dans la Ville rose au cours de la Seconde Guerre mondiale. Plus qu’une simple alliée de la Résistance, elle devient chef du secteur de Toulouse et de sa région en 1943, pour la ligne d’évasion Pat O’Leary lorsque son supérieur, le docteur Albert Guérisse, se fait emprisonner à Marseille.
Le mouvement est renommé « Françoise » et Marie-Louise Dissard poursuit ses activités clandestines en venant particulièrement en aide aux aviateurs alliés. Inarrêtable, la résistante parvient à secourir près de 700 personnes jusqu’à ce que la Libération soit déclarée.
Germaine Chaumel, la photographe intrépide
Née le 22 novembre 1895 à Toulouse, Germaine Chaumel est une femme aux multiples talents. Modiste, dessinatrice, ou encore pianiste, la jeune Toulousaine grandit dans une famille stricte mais ouverte aux arts. Pourtant, c’est en qualité de photographe que son talent est remarqué. Dès 1938, ses photographies racontent l’exil des réfugiés espagnols dans le Sud-Ouest de la France. Un an après seulement, les images prises par Germaine Chaumel documentent la privation et le froid que subissent les citoyens de la Ville rose peu avant le début de l’Occupation.
Lire aussi : À Toulouse, la difficile conservation de la mémoire de l’exil espagnol
Le 5 novembre 1940, elle est l’unique photographe autorisée à suivre le Maréchal Pétain lors de sa visite à Toulouse mais s’applique davantage à immortaliser la foule que le collaborateur. En 1944, elle s’arme de son appareil pour capturer la défaite imminente des Allemands depuis la Cité des Violettes. De la Dépêche du Midi au New York Times, son empreinte humaniste reste reconnaissable : jamais une goutte de sang n’a été photographiée par Germaine Chaumel.
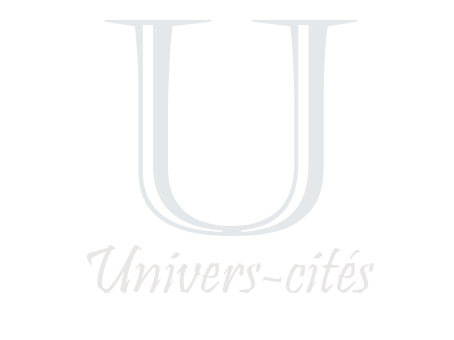









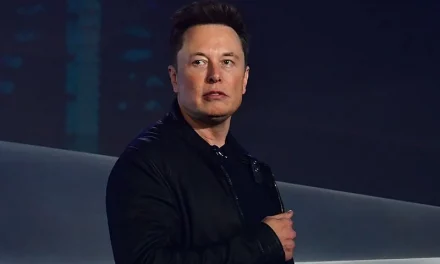

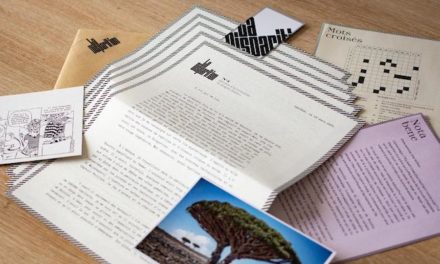










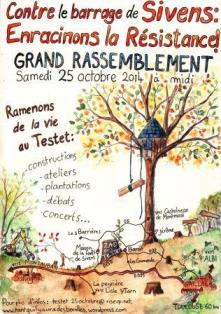







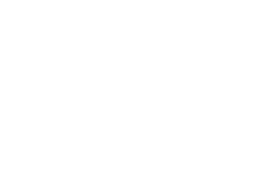 Suivez-nous sur Youtube
Suivez-nous sur Youtube