Suite à la sortie de son dernier livre, Les trente inglorieuses, le 14 janvier dernier aux éditions La fabrique, rencontre avec Jacques Rancière à la libraire des Ombres Blanches de Toulouse . L’occasion d’aborder avec le philosophe des enjeux politiques fondamentaux de notre époque comme la démocratie, le racisme ou la lutte des classes.
Univers Cités : Vous développez et centrez votre ouvrage autour de la question de consensus, pourquoi et comment le définiriez-vous ?
Jacques Rancière : Le point de départ a été l’effondrement du bloc soviétique. Le monde n’était plus divisé en deux. On était plus dans l’ère de la lutte, de la division. D’une certaine façon, il n’y avait alors plus d’alternative à la forme de gouvernement des pays riches. Et, à ce moment-la, il y a une idéologie qui annonce fièrement qu’il n’y aurait plus qu’un seul régime économique et politique appelé « démocratie« , qui voudrait dire un mode de gestion des affaires. On entre dans un monde où trouver des solutions, réunir des partenaires, simplement discuter serait le mot d’ordre. On observe un moment fort d’identification entre la démocratie et le consensus. Ce qui m’a donc amené à réfléchir au vrai sens de consensus. Le consensus, c’est un ensemble d’identifications, d’adéquations et de nécessité. Identification entre un système économique et un système politique. Adéquation entre un système de libre marché absolutiste et un système de gouvernement. Et nécessité de la mondialisation. Le consensus traduit une nécessité objective, qu’on ne discute pas.
« L’ennemi, c’est la jeune fille qui porte le voile. »
U. C. : Vous évoquez cette passion de l’intelligentsia de gauche sous deux aspects, celle de la violence raciste et des questions républicaines. Pouvez-vous développer ?
J. R. : J’ai observé un ralliement de toute une part de cette intelligentsia à l’ordre dominant, sous deux formes. Un ralliement à la nécessité d’un objectif global d’abord, puis le ralliement au combat républicain, qui s’est notamment exprimé dans la laïcité. L’ennemi, c’est la jeune fille qui porte le voile. Elle a permis de laisser tomber un universalisme pour un particularisme. À l’heure ou le socialisme et le communisme sont mis à mal, le républicanisme s’impose en progressisme social. C’est justement drôle de voir qu’à cette période, le parti de droite a fait le choix de s’appeler Les Républicains. De ce ralliement à l’ordre dominant est né, ce que j’appelle un « racisme d’en haut« . Le confort du discours officiel, qui s’exprime dans le populisme, normalise l’expression de racisme comme venant des couches populaires, des pauvres, des gens précaires. Aujourd’hui, ce qui est intéressant, c’est cette condition d’un racisme d’en haut qui enlève au racisme sale ses documents pour se donner une dignité politique et intellectuelle.
U. C. : Pourquoi questionnez-vous la démocratie et la représentation ?
J. R. : Le système dans lequel nous vivons n’est pas la démocratie. L’idée même de représentation est antinomique à l’idée de démocratie. Il a été inventé pour civiliser la démocratie. On est dans un système parfaitement oligarchique et qui l’est encore plus que quand il a été inventé. Ce qu’on a aujourd’hui, c’est un système représentatif dégénéré, et c’est ça qu’on appelle démocratie. La représentation, c’est seulement des délégations, des gens qui sont chargées d’exécuter les volontés du peuple. Pour moi, la définition minimale de la démocratie, c’est le pouvoir des égaux en tant qu’égaux. S’il y a une délégation, elle ne peut pas être fondée sur une différence de compétences.
« On est dans une période basse pour les idées et les pratiques de l’émancipation. »
U. C. : Comment définiriez-vous le moment politique ? Sommes-nous dans une période de recul du combat émancipateur ?
J. R. : L’idée normale, c’est qu’on n’est pas capable, qu’il y a une élite de gens plus instruits que les autres. Lorsque cette idée est brisée, alors les moments politiques se créent. Un moment où se suspend une espèce de consentement de subordination de ceux qui ne savent pas à ceux qui ne savent pas. Et ça s’est déclaré un certain nombre de fois, avec le mouvement des indignés, l’occupation des places, Nuit Debout. C’est ça pour moi un moment politique. On est dans une période basse pour les idées et les pratiques de l’émancipation. Dans un monde où les ennemis de l’émancipation nous gouvernent, on voit des pratiques émancipatrices. Par exemple ce qu’il s’est passé au Chili il y a deux ans. Il y a eu une remise en question de tout un système de gouvernement, de tout un ordre. On voit tous les jours des formes d’expériences, de volonté de construire un monde qui fasse droit à la capacité de tous. Mais c’est quelque chose qui est pour l’instant minoritaire.
U. C. : Quelle place accordez-vous à la littérature dans le retour des idées réactionnaires aujourd’hui ?
J. R. : Je ne dirai pas qu’il y a une vocation de la littérature pour les idées réactionnaires, car il y a toutes sortes d’écrivains. Mais, c’est vrai qu’on est dans une période où il y a une espèce d’appauvrissement de la veine fictionnelle. Beaucoup d’écrivains racontent leurs idées, leurs sentiments… et ça finit par être du ressentiment et donc de l’aigreur. Les écrivains mettent le littéraire au service de leur idéologie. Comme avec le cas Houellebecq, il y a cette espèce de double-jeu. La dignité de la littérature permet de donner part à ses idées réactionnaires, qui deviennent en fait plates. Et puis aujourd’hui, la littérature, c’est surtout une passion des personnes qui ont un bon statut.





















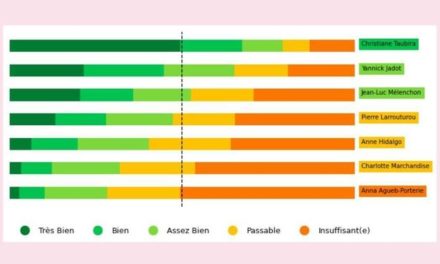









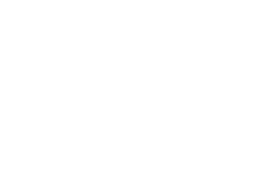 Suivez-nous sur Youtube
Suivez-nous sur Youtube