Marie, Stéphane, Guillaume, Christophe… sont des sans-abris. A Toulouse, les riverains les ont certainement déjà croisés, sans jamais vraiment y prêter attention. Ils sont parmi les 300 000 personnes sans domicile fixe, en France. La maraude, une action réalisée par des associations qui luttent contre le sans-abrisme, est l’occasion d’écouter et d’échanger avec ces personnes invisibilisées et marginalisées.
Marie fait partie des 1 000 à 3 000 personnes qui vivent dans la rue à Toulouse. Habituée des services de La Croix Rouge, elle attend sagement son passage, emmitouflée dans un imperméable gris. A côté d’elle, elle garde son bric-à-brac dans son caddie bleu, assorti à ses yeux. On devine difficilement son regard tant son bonnet est vissé sur sa tête. Elle, et son petit chien Pépito, se tiennent à l’angle de la rue Rémusat et de la place Victor Hugo, lorsque les six maraudeurs de La Croix Rouge viennent à sa rencontre. Dans l’animation nocturne toulousaine du vendredi soir, l’équipe de bénévoles s’attelle à la préparation d’une boisson chaude. Tandis que Pépito s’agite autour du barda de sa maîtresse, elle saisit le gobelet fumant à deux mains. « Il a fait beau aujourd’hui, il y a eu du soleil », relève Marie, dont la vie est en partie rythmée par la météo. La banalité de l’échange a quelque chose de déconcertant, tant on aurait de questions à poser à cette femme qui sort de l’ordinaire.
La conversation prend fin sous les aboiements des chiens de Stéphane, assis sur les marches des arcades de la place du marché, à quelques mètres de la vieille dame. Derrière lui, une multitude de cabas et de sacs en tout genre jonchent le sol. L’homme a l’allure d’un vieux rasta, avec ses dreadlocks et sa barbe grise. Éclairé par l’unique néon du parvis, on devine sous ses lunettes rondes les marques de la vie sans abris : ses joues sont creusées et les yeux cernés. S’il a autour des cinquante ans, il en fait pourtant dix de plus.
La solitude, conséquence de l’invisibilisation des sans-abris
Sur la place Wilson, Mohamed interpelle à la volée l’équipe de maraudeurs : « Eh ! C’est la brigade du bien ! ». L’ancien immigré algérien porte une immense veste style aviateur, trop grande pour lui. Ses mains fendent l’air lorsqu’il dépeint avec énergie le Toulouse de ses jeunes années. « Et la libraire Castéla, vous vous souvenez ? », questionne-t-il, avant d’enchaîner sur ses souvenirs des anciens bistros des allées du Président Roosevelt. À partir du récit de Mohamed, le groupe voyage dans le temps, se laisse porter dans sa vision de l’ancienne Ville rose. L’homme repart comme il était venu, en saluant avec vitalité la troupe de gilets rouges, satisfait d’avoir pu partager ces doux épisodes de sa vie d’avant.
Devant les immeubles de l’espace Saint-Georges, Ludo a établi son campement de fortune. Sous des couches de couverture, il défait le zip de sa tente, devant laquelle un tapis de faux gazon fait office de paillasson. La cadette du groupe de bénévoles lui propose une boisson chaude. « Une tisane s’il vous plaît, si je prends un café je ne vais pas dormir après », demande le quarantenaire à la barbe grisonnante. Gobelet fumant à la main, Ludo raconte son enfance à la campagne, auprès de son père qui était ébéniste. Sous son sourire qui se veut rassurant, on devine la nostalgie d’une existence sans galère. Assis sur une murette, son « pote Guillaume » chantonne « Et pour La Croix Rouge allez, allez ! ». D’abord d’humeur chantante, le jeune homme se laisse aller aux confessions. Une membre de l’équipe l’écoute longuement sur les épreuves qu’il a dû surmonter. Si, de son côté, Ludo tient un discours plus léger, les deux hommes manifestent ce besoin d’être entendus, écoutés. Là, réside la souffrance du sans-abri, duquel les regards se détournent, fuient.

« Qu’est-ce qui pourrait bien aller ? »
Lorsque les deux hommes semblent avoir le cœur un peu plus léger, les maraudeurs les saluent avant de s’éloigner. Un peu plus loin, sur le parvis de la place Occitane, ils retrouvent Christophe, installé ici depuis quatre ans. À la question « Comment vas-tu ? », ce dernier rétorque : « Qu’est-ce qui pourrait bien aller ? ». L’homme ressemble à un cow-boy, avec son chapeau et ses bottes santiags. Assis jambes tendues à l’entrée de sa tente, Christophe fait état de sa santé, « qui se dégrade chaque jour », et du froid « qui m’oblige à boire pour me réchauffer ». L’homme sent le besoin de justifier la présence de cette bouteille de whisky remplie aux deux tiers : « Je buvais pas avant, mais il fait tellement froid le matin, je n’ai que ça pour avoir chaud ». Lui, comme Tatane, rencontré plus tôt, ou encore Guillaume, groggy sous l’effet de substances, ont trouvé cet échappatoire à la dureté de la réalité. D’abord tendue, l’atmosphère s’adoucit au fil de la conversation. Christophe sourit même lorsqu’il présente fièrement, à l’ensemble du groupe, sa dernière acquisition : un briquet Zippo joliment gravé. « Vous voyez, même si j’suis dans la rue, j’ai toujours le goût des belles choses » se défend-il. À cette heure tardive, les rues autour d’eux sont moins animées, les terrasses vides et les rideaux baissés. Les sans-logis seront parmi les seuls témoins de cette ville endormie.
Crédits photo : Léna Saoui





















![[VIDEO] Les primaires américaines, ça se passe aussi à Toulouse](https://www.univers-cites.fr/wp-content/uploads/2016/03/arton2397.jpg)








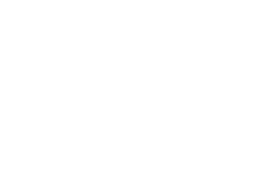 Suivez-nous sur Youtube
Suivez-nous sur Youtube