Depuis WikiLeaks en 2010 jusqu’à l’affaire Snowden aujourd’hui, les hackers occupent une place particulière dans la production journalistique. Qui sont-ils ? Quelles relations entretiennent-ils avec les journalistes ? Comment travailler en commun ? La 7e édition des Assises Internationales du journalisme à Metz, jeudi 7 novembre, proposait d’apporter des réponses à toutes ces questions. Auteur en 2013 de « Hackers : au cœur de la résistance numérique », Amaelle Guiton, journaliste indépendante passée par la matinale sur Le Mouv’, animait cette rencontre. « Univers-Cités » a interviewé celle qui a enquêté deux ans durant parmi les communautés de hackers pour en analyser les ressorts et l’importance dans le travail journalistique.

« Univers-Cités » : Comment, et pourquoi, ce livre « Hackers, au cœur de la résistance numérique » a émergé ?
Amaelle Guiton : Il y a deux réponses en fait. Une réponse sur un temps long et une réponse sur un temps court. J’ai toujours été assez geek. Je suis d’une génération qui a connu des ordinateurs sur lesquels il n’y avait pas d’icônes. Il fallait taper du code. Quand j’étais toute petite, j’ai vécu le plan informatique pour tous [NDLR, un programme national du gouvernement français pour enseigner l’informatique à 11 millions d’élèves en 1985] et j’ai toujours eu un rapport assez friendly aux ordinateurs de manière générale. Du coup, je me suis intéressée dès la fin des années 1990 aux logiciels libres. J’en ai utilisé assez tôt donc j’ai toujours eu un goût pour ce genre de sujets, sans jamais – ce qui est étrange – croiser des hackers alors qu’ils sont complètement dans ces réseaux-là.
Puis, il y a eu WikiLeaks, et là comme beaucoup de journalistes, je me suis pris le truc en pleine tête en me disant : « Ces mecs, ils font le boulot des journalistes. » C’est eux qui amènent des documents, ils les publient, ils passent des accords avec des rédactions, mais selon leurs conditions. On a vraiment un nouvel acteur. Pour moi, il se passait quelque chose : les hackers arrivaient dans la production de l’information.
J’ai croisé l’exact inverse : des communautés très ouvertes, des gens prêt à discuter, à transmettre de la connaissance, de la compétence et au contraire très sociables.
Ensuite, il y a eu Anonymous, ils se sont invités en politique : c’est vraiment l’émergence de ce qu’on appelle le « hacktivisme ». J’ai alors commencé à gratter un peu et à aller discuter avec des Anonymous sur des canaux de discussion en ligne, à rencontrer les gens de Telecomix parce qu’ils commençaient à organiser des choses autour de la sécurité des communications. Je me suis rendue compte, et ça a été ça le déclencheur, qu’on avait l’image d’une communauté très fermée, de gens complètement hermétiques, dans leur monde, asociaux alors que j’ai croisé l’exact inverse : des communautés très ouvertes, des gens prêt à discuter, à transmettre de la connaissance, de la compétence et au contraire très sociables. Je me suis dit : il y a une histoire à raconter.
Comment s’est passée cette rencontre avec les hackers ? Qui sont-ils ?
J’y suis vraiment rentrée par le biais de ce qu’on appelle le « hacktivisme » : c’est-à-dire des gens qui sont des militants de la liberté d’informer. Ce qui fait le pont entre le projet WikiLeaks, Anonymous, Telecomix ou d’autres groupes comme la Quadrature du net, qui sont plus dans une démarche d’interpellation des politiques par rapport à ces questions-là, ce qui les met tous d’accord, c’est vraiment les libertés sur Internet : la liberté d’informer et de s’informer, la liberté de communiquer et la liberté de partage. C’est probablement la partie de la communauté hacker qui est la plus communicante.
Il y a eu beaucoup de paresse, beaucoup de clichés de la part des journalistes,entre autres.
Quand on commence à s’intéresser à toutes les questions de ce qu’on appelle l’Infosec [NDLR, Infosecurity en anglais], c’est-à-dire la sécurité des systèmes, c’est plus compliqué, c’est plus masculin et c’est en général un peu moins communicant, etc. Mais les hacktivistes sont des gens qui n’ont qu’une envie : qu’on discute avec eux, qu’on vienne à leur rencontre, mais de manière générale les communautés hackers sont infiniment plus ouvertes que ce qu’on dit.
Il y a eu beaucoup de paresse, beaucoup de clichés de la part des journalistes, entre autres, mais la rencontre elle s’est faite finalement assez naturellement en discutant en ligne, en les croisant dans la vraie vie dans divers événements, etc. On va dans des événements hackers : cet été, j’étais aux Pays-Bas, ils étaient 3000 rassemblés au même endroit. Il peut y avoir parfois de la défiance vis-à-vis des journalistes parce que, justement, il y a eu ces clichés pendant très longtemps. Une fois que c’était levé au contraire, ce sont des gens prêts à vous aider.

Quelle relation entretiennent-ils aujourd’hui avec les journalistes ? Leur sont-ils devenus indispensables ?
Ils sont devenus indispensables parce qu’ils ont des compétences techniques que les journalistes n’ont pas. C’est ça qui est fou : on dit du hacker que c’est un pirate, or, ce sont des hackers qui m’ont appris à me protéger, c’est-à-dire à faire en sorte que, quand je communique avec une personne, il n’y a qu’elle et moi qui puissions lire les messages. On a besoin de ces gens-là pour protéger des sources, pour se protéger soi-même, car les journalistes ont besoin de protéger leur travail, ils ont besoin de se protéger quand ils vont sur le terrain, etc.
L’idée qu’il puisse y avoir des contaminations réciproques entre ces deux groupes ça nous force en tant que journalistes à sortir de notre confort ou de nos méthodes traditionnelles.
Après ça va au-delà, c’est des gens qui sont très inventifs, qui vont développer des tas de trucs, qui vont être capables de trouver des réponses parfois assez étonnantes à des problèmes très concrets. Quand on est journaliste, on a aussi besoin de réfléchir comme ça. L’idée qu’il puisse y avoir des contaminations réciproques entre ces deux groupes, ça nous force en tant que journalistes à sortir de notre confort ou de nos méthodes traditionnelles.
Justement, comment s’est matérialisée cette relation entre hackers et journalistes ?
Il n’y a rien de structurel ou d’institué. Le seul cas que je connaisse, c’est celui de la collaboration de WikiLeaks avec The Guardian ou The New York Times, ce qui a d’ailleurs créé des conflits. C’est là aussi qu’on voit que ce n’est pas simple parce que les logiques ne sont pas forcément les mêmes. Après au niveau individuel, par contre, il y a des passerelles. Ça peut être l’apprentissage de la sécurité des communications, des échanges sur des questions techniques, des échanges sur des questions de fond et de l’expertise. Sur les questions de surveillance, par exemple, on a besoin de gens qui comprennent, tout simplement ce qu’il y a dans les documents.
Des rédactions vont commencer à embaucher des hackers pour justement faire de l’expertise parce que c’est nécessaire.
Sur les dossiers Snowden, il y a des journalistes, dont Glenn Greenwald,
et Laura Poitras, qui travaillent avec des experts, comme Jacob Appelbaum à Berlin. Il y a du travail commun, parce qu’il y a besoin des deux. Il y a besoin de gens qui savent mettre en contexte, raconter une histoire autour de ça, et puis il y a besoin de gens qui savent dire vraiment ce qu’il y a dans les documents. Pour le moment, ça se fait plus entre des personnes qu’entre des structures, ce qui est assez logique finalement parce que les hackers sont des gens qui travaillent beaucoup en mode décentralisé.
Est-ce que l’on va quand même vers une forme d’institutionnalisation de cette relation ?
Pas forcément sur le long terme. Il pourra se passer des choses, des rédactions vont commencer à embaucher des hackers pour justement faire de l’expertise parce que c’est nécessaire. Mais ce n’est pas de l’institutionnalisation. Imaginer des partenariats de long terme entre des structures type WikiLeaks et des journaux, c’est trop compliqué. Il y a cette idée d’horizontalité dans le hacking qui est assez contradictoire avec la manière dont fonctionnent les organes de presse. Les organes de presse sont pourtant frappés par l’Internet, et ils vont être obligés de se réinventer. Ce ne sera pas forcément de l’institutionnalisation, mais des logiques de travail commun plus étroites que ce qu’elles sont aujourd’hui.
L’éthique hacker et l’éthique journaliste sont-elles vraiment concomitantes ?
C’est une question compliquée car ce n’est pas exactement la même chose, mais ça peut s’articuler. Dans l’éthique du hacking, il n’y a rien par rapport à la loi, par rapport à la légalité. Par contre, il y a des choses très fortes par rapport à la légitimité de ce qu’on fait. Les hackers ont une éthique : ils savent faire tellement de choses qu’ils se fixent des limites, mais il n’y a pas forcément des nécessités de se comporter en fonction des législations. Ce qui est plus compliqué pour les journalistes. En revanche, dans les deux, il y a quand même l’idée qu’il faut faire circuler l’information, que ce qui est caché doit être mis au jour. Et c’est le cas pour les journalistes, bien heureusement.

Est-ce que cette image négative des hackers a un peu changé ?
Elle change petit à petit par la force des choses. De plus en plus de journalistes se rendent compte qu’ils ont besoin des compétences des hackers, qu’il faut qu’il y ait des passerelles entre les deux pour l’exercice de leur métier : pour se protéger et protéger leurs sources. Ça devient absolument crucial. Dans le grand public, ça va mettre plus longtemps à bouger, mais leur image a commencé à changer notamment, autour des affaires de surveillance et des printemps arabes.
Dans ton livre, tu dis : « C’est la dystopie, la « contre-utopie » qui aujourd’hui nous guette disent-ils. Le spectre d’un monde sous surveillance ». L’Internet est de moins en moins libre, c’est ton constat ?
Il y a deux tendances qui se jouent en même temps. Internet permet à de plus en plus de gens de communiquer, de se mettre en réseau, ça pousse à la décentralisation, à l’horizontalité, à ce que les marges fassent émerger des choses qui petit à petit contaminent le cœur des systèmes sociaux, politiques, etc. Et ça donne des choses très enthousiasmantes. En revanche, de l’autre côté, il y a de plus en plus de contrôle sur Internet dans les pays qui se servent de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 pour caler la table : il y a de la censure, il y a de la surveillance et il y a même des cas où il y a eu des coupures du réseau comme en Egypte. C’est devenu un enjeu et c’est très effrayant.
C’est complètement fou que des démocraties, de facto, fichent des populations entières puisque c’est à ça que ça revient.
Mais ce qui l’est encore plus, c’est que dans les sociétés démocratiques, c’est-à-dire qui sont censées garantir la protection de la vie privée, on se rend compte, aujourd’hui que la surveillance n’est pas de la surveillance ciblée vis-à-vis de gens dont on pense qu’ils pourraient être potentiellement des dangers pour la sécurité des sociétés, mais de la surveillance de masse. On surveille tout le monde. Ce n’est pas de la surveillance de tout le monde tout le temps et on n’a pas Big Brother qui plaque son gros œil, mais ce sont des tas et des tas de données qui sont agrégées dans des data centers et qui concernent tout le monde.
C’est complètement fou que des démocraties, de facto, fichent des populations entières puisque c’est à ça que ça revient. C’est très inquiétant sur le fond politique. C’est une tendance lourde à laquelle des gens commencent à réagir. On a vu les premières manifestations, les gens qui fabriquent Internet réfléchissent beaucoup à comment ils pourraient le rendre plus résistant contre la surveillance généralisée. Mais c’est vrai qu’on n’est pas dans de la surveillance telle qu’elle peut s’exercer dans les régimes totalitaires où c’est quelque chose qui pèse presque physiquement, où on se méfie de son voisin, où on sait qu’on peut être dénoncé du jour au lendemain.




















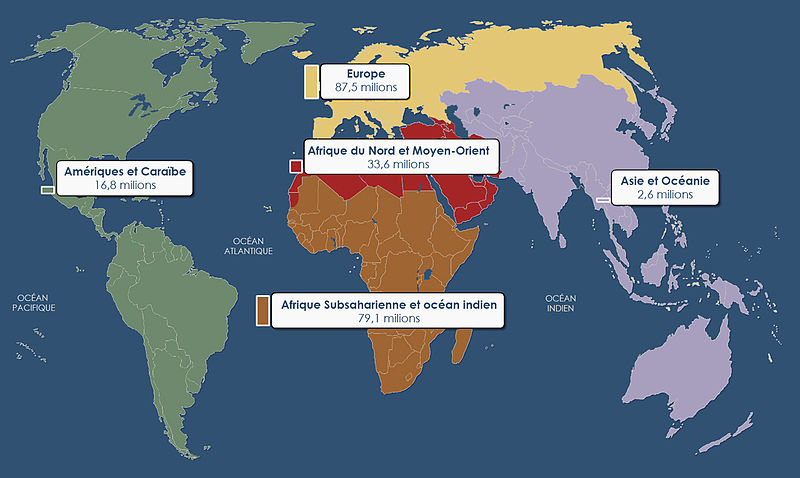









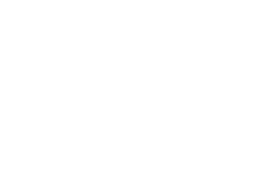 Suivez-nous sur Youtube
Suivez-nous sur Youtube